La signalisation ferroviaire
Color-light
 1904.
C'est cette année-là, qu'on installa le premier signal de type
color-light dans le East Boston Tunnel. Par le suite, le Long island RR
commença à signaler sa ligne vers le Grand Central Terminal du New York
Central. L'ère des signaux n'ayant pas de bras commençait.
1904.
C'est cette année-là, qu'on installa le premier signal de type
color-light dans le East Boston Tunnel. Par le suite, le Long island RR
commença à signaler sa ligne vers le Grand Central Terminal du New York
Central. L'ère des signaux n'ayant pas de bras commençait.
Deux handicaps ont empêché ce type de signal d'apparaître plus tôt: la faiblesse des lampes incandescentes en plein jour (lumière difficilement visible contre le soleil), et la difficulté de colorer des vitres efficacement. Lorsque General Electric mis au point des lampes suffisamment puissante pour être vues en plein soleil, et que Corning Glass résolu le problème de la teinture des vitres, le reste alla tout seul.
Rapidement, dès 1913, on ajouta aux signaux de type color-light un "doublet", une lentille double à effet de loupe, qui permit de concentrer le faisceau pour que ce dernier soit visible d'aussi loin que 4000 pieds. On ajouta aussi un prisme, qui permit de faire dévier une partie du faisceau afin que le signal soit aussi visible de près, afin d'assurer une pleine visibilité au fur et à mesure qu'on s'approchait du signal. Finalement, un capot, produisant un ombrage constant sur la lentille améliora grandement la performance du signal le jour. Aujourd'hui, comme le montre la photo, les nouveaux signaux de type color-light ont des unités à LED, ce qui donne une couleur très vive, même à contre-jour.
Les signaux de type color-light ont été rapidement adoptés, car comme ils ne contiennent aucune pièce mobile, ils ont été préféré aux sémaphores qui, avec leur mécanisme relativement complexe, étaient beaucoup plus couteux à entretenir. Les color-light ont été dessiné pour remplacer les sémaphores à quadrant supérieur: la lumière verte en haut, comme le bras du sémaphore,. La jaune au centre, comme lorsque le bras du sémaphore est entre l'horizontal et la vertical (45 degrés),. Finalement, le rouge en bas. Donc, les signaux de type color-light possèdent trois lumières par unités. De haut en bas: vert, jaune et rouge.
La position du rouge en bas (que l'on nomme arrangement irlandais) a aussi une notion d'autofiabilité: comme les débris et la neige peuvent s'acumuler sur les capots de lentilles, ils peuvent obstruer la vue de la lentille qui est au-dessus du capot. Or, la lumière rouge étant en bas, aucune neige ne peut s'accumuler pour obstruer la vue (mis à part le fait que le neige peut coller directement sur la lentille).
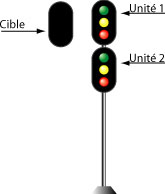 Sur
un signal de type color-light, les lumières sont regroupées pour donner
les indications. C'est la cible qui détermine le groupement. Une cible
ne comportent que les lumières nécessaires. Si le vert ne s'allume
jamais, alors il ne sera pas présent sur la cible. De plus, si deux
lumières venaient à s'allumer sur la même cible, le signal devra être
considéré comme défectueux.
Sur
un signal de type color-light, les lumières sont regroupées pour donner
les indications. C'est la cible qui détermine le groupement. Une cible
ne comportent que les lumières nécessaires. Si le vert ne s'allume
jamais, alors il ne sera pas présent sur la cible. De plus, si deux
lumières venaient à s'allumer sur la même cible, le signal devra être
considéré comme défectueux.
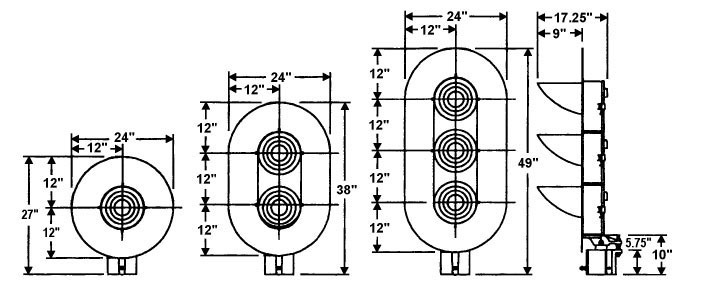 À
l'époque de leur lancement, les signaux de type color-light ont
rencontré quelques détracteurs. Ils consommaient beaucoup plus
d'électricité que les sémaphores qu'ils remplaçaient. Ce fut assez
problématique, car à la base, le système fonctionne toujours sur des
batteries (voyez la page sur les circuits de voie).
De plus, un sémaphore donne toujours un aspect, que le système soit
fonctionnel ou pas. Le bras sera dans une position quelconque. Lorsque
le système a une défaillance, le bras du sémaphore, par gravité, revient
à l'horizontal pour indiquer un "arrêt". Or, le signaux de type
color-light, peuvent avoir une ampoule brûlée. Dans ce cas, impossible
de connaître l'aspect du signal. Pour palier à ce manque, plusieurs
chemins de fer ont câblés leur signaux pour que ceux-ci donne un aspect
immédiatement plus restrictif en cas de défaillance. Par exemple, si
l'ampoule verte brûle, l'ampoule jaune allumera automatiquement.
Certaines compagnies ont même été jusqu'à câbler le système afin que
l'aspect du signal précédent change aussi pour un aspect plus
restrictif. Cette pratique ne fut pas adoptée universellement, car si le
signal affichait un aspect d'approche au moment de la défaillance, il
donnait automatiquement un aspect d'arrêt. Un ingénieur arrivant en même
temps et voyant le signal changer pour un signal d'arrêt aurait
tendance à freiner en urgence, risquant ainsi de provoquer un
déraillement.
À
l'époque de leur lancement, les signaux de type color-light ont
rencontré quelques détracteurs. Ils consommaient beaucoup plus
d'électricité que les sémaphores qu'ils remplaçaient. Ce fut assez
problématique, car à la base, le système fonctionne toujours sur des
batteries (voyez la page sur les circuits de voie).
De plus, un sémaphore donne toujours un aspect, que le système soit
fonctionnel ou pas. Le bras sera dans une position quelconque. Lorsque
le système a une défaillance, le bras du sémaphore, par gravité, revient
à l'horizontal pour indiquer un "arrêt". Or, le signaux de type
color-light, peuvent avoir une ampoule brûlée. Dans ce cas, impossible
de connaître l'aspect du signal. Pour palier à ce manque, plusieurs
chemins de fer ont câblés leur signaux pour que ceux-ci donne un aspect
immédiatement plus restrictif en cas de défaillance. Par exemple, si
l'ampoule verte brûle, l'ampoule jaune allumera automatiquement.
Certaines compagnies ont même été jusqu'à câbler le système afin que
l'aspect du signal précédent change aussi pour un aspect plus
restrictif. Cette pratique ne fut pas adoptée universellement, car si le
signal affichait un aspect d'approche au moment de la défaillance, il
donnait automatiquement un aspect d'arrêt. Un ingénieur arrivant en même
temps et voyant le signal changer pour un signal d'arrêt aurait
tendance à freiner en urgence, risquant ainsi de provoquer un
déraillement.
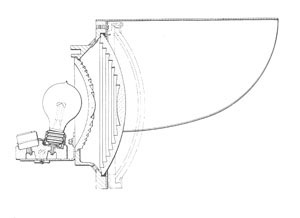 Les
signaux de type color-light ont commencé leur brillante carrière avec
les transports en commun (métro et autres). En 1915, The Milwaukee Road
fut le premier chemin de fer à choisir d'implanter des signaux de type
color-light partout, notamment sur sa "Pacific Extension". Puis
ce fut le tour de Lackawanna, Nickel plate Road, Chesapeak & Ohio,
Illinois Central, Rio Grande, Union Pacific et Santa Fe. Le ton était
donné!
Les
signaux de type color-light ont commencé leur brillante carrière avec
les transports en commun (métro et autres). En 1915, The Milwaukee Road
fut le premier chemin de fer à choisir d'implanter des signaux de type
color-light partout, notamment sur sa "Pacific Extension". Puis
ce fut le tour de Lackawanna, Nickel plate Road, Chesapeak & Ohio,
Illinois Central, Rio Grande, Union Pacific et Santa Fe. Le ton était
donné!
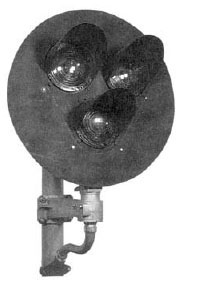 Le
type color-light avait un autre défaut: celui de sa hauteur. Trois
unités, de trois lumières chacune, produisent en signal très haut, qui
n'est pas pratique. Lorsque le signal affiche un aspect vert sur rouge
sur vert, par exemple, la lumière verte du haut et la lumière rouge sont
très éloignées, alors que la lumière rouge du centre et le verte du bas
sont très rapprochées, ce qui peut porter à confusion. De plus, la
hauteur de la troisième unité causait problème dans certains lieux
restreints, comme les chemins de fer ayant une caténaire. Pour résoudre
ce problème, US&S inventa, en 1924, le type "V". Ce type de
color-light, inutilisé au Canada, se sert de la même cible que le
searchlight, et dispose les lampes en "V", soit le jaune à gauche, le
vert à droite et le rouge au centre, en bas. Les trois lampes cohabitent
dans le même cabinet pour une raison d'autofiabilité. Supposons que la
porte d'une des lampes demeure ouverte (oublie, vandalisme, vent,
etc...). La lumière du soleil entrant par la porte donnera un faux
aspect. Or, si la même porte sert pour les trois lampes, dans le cas
d'une porte ouverte, le soleil fera "allumer" les trois lampes en même
temps, ce qui ne corrsspond à aucun aspect. Le patron du "V" demeure
encore un des types de signaux les plus populaires des États-Unis.
Le
type color-light avait un autre défaut: celui de sa hauteur. Trois
unités, de trois lumières chacune, produisent en signal très haut, qui
n'est pas pratique. Lorsque le signal affiche un aspect vert sur rouge
sur vert, par exemple, la lumière verte du haut et la lumière rouge sont
très éloignées, alors que la lumière rouge du centre et le verte du bas
sont très rapprochées, ce qui peut porter à confusion. De plus, la
hauteur de la troisième unité causait problème dans certains lieux
restreints, comme les chemins de fer ayant une caténaire. Pour résoudre
ce problème, US&S inventa, en 1924, le type "V". Ce type de
color-light, inutilisé au Canada, se sert de la même cible que le
searchlight, et dispose les lampes en "V", soit le jaune à gauche, le
vert à droite et le rouge au centre, en bas. Les trois lampes cohabitent
dans le même cabinet pour une raison d'autofiabilité. Supposons que la
porte d'une des lampes demeure ouverte (oublie, vandalisme, vent,
etc...). La lumière du soleil entrant par la porte donnera un faux
aspect. Or, si la même porte sert pour les trois lampes, dans le cas
d'une porte ouverte, le soleil fera "allumer" les trois lampes en même
temps, ce qui ne corrsspond à aucun aspect. Le patron du "V" demeure
encore un des types de signaux les plus populaires des États-Unis.
Le signal de type a color-light a ensuite perdu un peu de terrain face au signal de type searchlight, plus flexible, plus sophistiqué, et plus facile d'interprétation, puisque seule la couleur change, et non l'emplacement physique de la source de la couleur.
Mais depuis les années 1980, le color-light a repris du terrain, notamment à cause de son très faible coût d'achat, et d'entretien. Il est le type de signal le plus courant au monde.